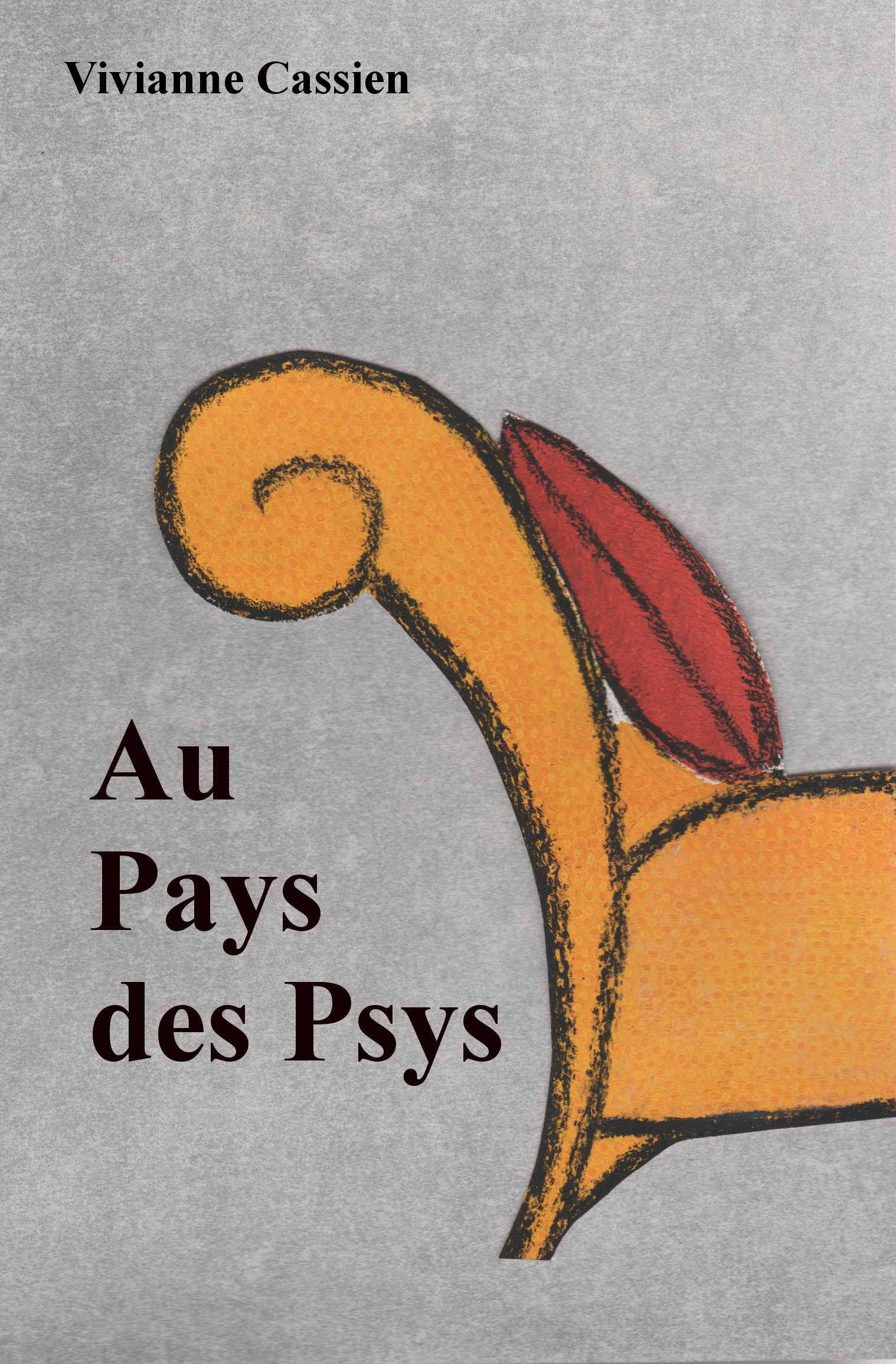Bien malgré moi, j’ai fréquenté assidûment les cabinets de psychiatres, psychanalystes et autres psychologues,parce que j’étais affligée d’un mal qui leur resta longtemps mystérieux. Quoique, sur le moment, ces expériences n’aient pas été follement gaies, je me suis beaucoup amusée à décrire mes divers thérapeutes, les relations très asymétriques qu’ils instaurent avec le patient, le décor de leur cabinets, leurs interminables erreurs de diagnostic (étirées sur dix ans, dans mon cas). De fait, il fallut que je sois internée en hôpital psychiatrique, l’année de mes vingt-sept ans, pour qu’enfin on mette un nom sur mes troubles, proclamés désormais « bipolaires ». Au risque de vous choquer, je préfère employer le mot « folie », plutôt que le terme malsonnant de « maladie mentale ». A ma façon, je suis proche de l’esprit des « mad pride » – qui s’inspirent des « gay pride » mieux connues. Aussi longtemps que la société enfermera les fous au sens propre (dans les HP), mais surtout au figuré (dans les préjugés), ils auront honte de leurs pathologies et en souffriront doublement. Ces a priori infamants, je tente de les bousculer en décrivant avec cocasserie mes pérégrinations au pays des psys.
Découvrir tous les livres de Vivianne Cassien
Voici quelques extraits du livre :
Bien des patients « physiques » mènent des combats que tout le monde s’accorde à trouver héroïques ou du moins méritoires, quand les malades mentaux se débattent sans gloire. Personne ne salue jamais la bravoure de ceux qui, comme moi, traversèrent moult dépressions : au contraire on me soupçonne d’être un loser multirécidiviste. Mes progrès éventuels n’impressionnent guère : on se dit simplement que je me suis ressaisie, que je me suis enfin prise en main pour me rallier au sens commun. Ce que cela suppose de persévérance et de ténacité, nul ne le voit, nul ne le sait, et je ne peux guère m’en glorifier. Et, si je vais mieux au point de paraître « normale », on trouve cela tout-à-fait normal justement, sans mesurer l’effort immense consenti pour en arriver là.
À maladie invisible, mérite invisible. Personne ne va me féliciter ni s’extasier de mes progrès. Pourtant, l’énergie que j’ai dépensée ressemble assez à celle qu’un paralysé déploie pour réapprendre à marcher – mais, là, on est dans le visible, dans le spectaculaire, donc le bon peuple s’émerveille.
Et même ceux qui meurent terrassés par leur tumeur sont décorés d’une médaille – tandis que les dépressifs qui succombent à leur maladie ne récoltent aucun laurier pour cela, au contraire. La bipolarité est la maladie mentale où le risque de mortalité est le plus grave, mais un suicidé n’a pas l’aura d’un cancéreux mort au combat. Tout simplement, parce que celui qui se supprime est jugé lâche, et le second martyr. Il y a des morts plus valeureuses que d’autres.
Les pires récits de pathologie physique n’atteindraient-ils pas en horreur la folie ? Pourtant, le vécu d’un grand brûlé, d’un amputé, dépasse aussi beaucoup l’imagination. Mais leur mal au moins est visible. Même une tumeur au cerveau, insoupçonnable vue du dehors, est perceptible au moins par l’imagerie médicale. Et surtout, celui qui souffre physiquement peut conserver un discours raisonnable. Même si son corps est déformé par le mal, sa parole garde une apparence normale. Aussi terribles que soient les atteintes corporelles, l’essentiel est préservé du moment que la tête marche droit. L’humanité est intacte, le dialogue aussi.
Il me semble que les préventions qui pèsent sur les maladies mentales sont telles que, dès qu’on enlève cette étiquette, bien des tabous sont levés. La cause de l’homosexualité a beaucoup avancé, et l’une de ses victoires (du moins en Occident) est de ne plus être assimilée à une maladie mentale (en France, depuis 1981). La revoilà la grande infamie, qui supplante presque toutes les autres ! Les gays, en tant que gays, sont donc sains d’esprits, tant mieux pour eux, ils sont ainsi délestés de la pire des tares.
Les autistes ont connu la même réhabilitation. Longtemps, les médecins se sont mépris sur leur souffrance, et les ont envoyés en hôpital psychiatrique. Tant que dura cette politique, leur image dans l’opinion était désastreuse. Mais, dès l’instant où leur affection a été dé-psychiatrisée, la perception du public a changé. D’emblée, les parents d’autistes se sont sentis déculpabilisés, ce qui a permis à beaucoup d’entre eux d’appréhender différemment la maladie, et par là même de mieux aider leur enfant.
Le handicap mental suscite de telles peurs qu’il éveille rarement l’empathie. Cela va bien au-delà du simple préjugé : il s’agit d’une faille très intime, qui empêche certains (la majorité) d’accueillir la souffrance dès lors qu’elle est psychique. Souvent les êtres les plus sensibles, les plus susceptibles de compassion d’ordinaire, prennent peur. Ils ne veulent pas sombrer dans le vertige d’une ressemblance avec moins normal qu’eux.
Si bien que toute maladie psychique est une école de solitude.
J’ai financé l’érection d’un mur de marbre noir – que dis-je, d’un mausolée tout tapissé de cette noirceur luxueuse et sépulcrale, et destiné cependant à des vivants. J’eus à traverser ce tombeau souvent, chaque fois que j’allais consulter mon psychiatre.
Je n’étais certes pas la seule donatrice : bien d’autres que moi, en s’acquittant de généreux dépassements d’honoraires, avaient contribué à ce monument. J’estimais que plusieurs centimètres carrés (ou décimètres peut-être?) me revenaient, et que j’aurais pu y apposer mon nom. Car, si j’additionnais les sommes qu’il m’avait fallu verser, jusqu’à six fois la semaine – le dimanche étant alors mon seul jour de relâche – j’atteignais une somme rondelette.
L’honnêteté m’oblige à dire que je faisais mauvais usage de tout ce temps que si libéralement ce praticien m’accordait, car des mois durant je vins à ses convocations matutinales (7h45 exactement) en gardant serrées les dents, et je crois bien qu’aucune phrase complète n’en sortit, car si d’aventure me venait un sujet, le verbe ou le COD me faisaient invariablement défaut. Ce qui eût pu l’exaspérer le faisait ricaner au contraire, et il s’amusait à railler ma syntaxe déficiente, comme si ç’avait été du dernier comique. Il avait cette chance de savoir rire de tout, même du ridicule des mélancoliques profonds qui d’ordinaire n’amusent personne.
Sans doute, par une sorte d’inversion des pôles, trouvait-il aussi son marbre noir hilarant ? Je le soupçonnais de se nourrir de toute cette noirceur morale ou marbrière, d’en sucer la morbide moelle pour y puiser sa force vitale. Car, plus je m’enfonçais, affligée par ses ricanements autant que par ses funèbres fauteuils, plus il semblait prospérer. Et, à chaque patient, à chaque séance, il pouvait doublement se repaître, il avalait goulûment la noirceur tout en songeant à l’objet enténébré qu’il pourrait bientôt acquérir avec tout l’argent qu’il amassait minute après minute. Cette transmutation de la douleur en fric avait quelque chose d’exaltant, d’autant que la magie opérait sans qu’il ait vraiment besoin d’y mettre du sien. Quand il ne ricanait pas, il restait de marbre et laissait le patient dire ou se taire, sans intervenir. Accoudé à son siège directorial, il joignait le bout de ses phalanges. Derrière ce paravent il pouvait se retirer en paix, tout en balayant discrètement du regard le décor de son bureau, sa vue sur les quais, ses rayonnages de livres imposants. Il appréciait tout ce luxe en connaisseur. Il pouvait s’autoriser toutes les rêveries, sûr que nul ne songerait à décrypter ses silences.
Il arborait des costumes de grand prix qu’il choisissait, pour se distinguer du tout-venant, avec un col Mao. Toute l’année il entretenait un bronzage qui lui aurait presque donné bonne mine, s’il n’avait péché par excès : on sentait que ce teint trop sombre n’avait rien de naturel – le soleil n’y était pour rien. Cela renforçait mes soupçons à son égard, je l’imaginais fuyant le grand air et l’astre du jour, vivant seulement entre ses deux lieux d’inhumation, son cabinet et son appartement qui à coup sûr déclinait sa gamme de couleurs favorites, du charbon à l’anthracite. C’était là sa définition du chic, le design ne pouvant à ses yeux s’égarer dans de joyeux bariolés. Il lui fallait, pour se sentir élégant, porter des vêtements assortis à ses murs, à ses sièges et à ses tables, et choisir des matières nobles que le noir rehaussait.
Cette manie du sombre je l’ai retrouvée chez plus d’un psy, jusqu’à ce qu’un jour, bien des années plus tard, je crus enfin en avoir déniché un qui détonait par son style. Sur ses murs blancs défraîchis, il alternait, sans souci d’harmonie, des lithographies abstraites aux teints vifs, et des aquarelles surannées montrant la flèche de la cathédrale. Le manque d’unité, au lieu de me faire fuir, me rassura plutôt : cela me changeait de l’excès de cohérence des précédents. Et puis, selon que l’on était assis à gauche ou à droite de la porte, on pouvait opter pour le passéisme artistique, ou la modernité. Or, un été, tandis que j’avais moi-même repeint l’une de mes pièces en turquoise et rouge, il fallut que ce psy lui aussi fît des travaux de peinture. Hélas, trois fois hélas, il avait cédé, comme les autres, aux sirènes du gris foncé. Peut-être voyait-il dans ce choix une preuve de son élégance, à moins que ce ne fût un signe d’appartenance à sa confrérie ? Quoi qu’il en fût, l’anthracite à haute dose me fit un effet immédiat : je sentis mon humeur s’assombrir aussitôt, et s’assortir aux murs. N’était-ce pas là le but recherché ? N’était-ce pas finalement le même procédé dont usent les supermarchés pour aiguiser l’appétit de leurs chalands, en choisissant pour la viande ou les légumes un éclairage alléchant ? Dans les deux cas, il
s’agissait de conditionner les clients pour qu’ils consomment davantage. Je ne saurais dire à quel point cette stratégie était délibérée, mais je ne voudrais pas insulter mon psy en la disant inconsciente. Si je le soupçonne d’avoir calculé son effet, c’est que, dans son océan de gris, il avait fait une exception dont il était le seul à profiter : assis à son bureau, ou à côté de son divan, il voyait, lui, un mur carmin. C’est donc qu’il pratiquait, pour son seul bénéfice, une forme de chromothérapie plus joyeuse. Il s’octroyait le droit d’un peu de gaieté et de stimulation, tandis qu’il laissait ses clients sombrer dans le sombre. J’avoue qu’en découvrant ce petit pan de mur vermillon, je lui en ai voulu, comme s’il cherchait à me priver délibérément des couleurs de la vie.
Rendez-vous également sur la page Facebook officielle du livre « Au pays des psys »: